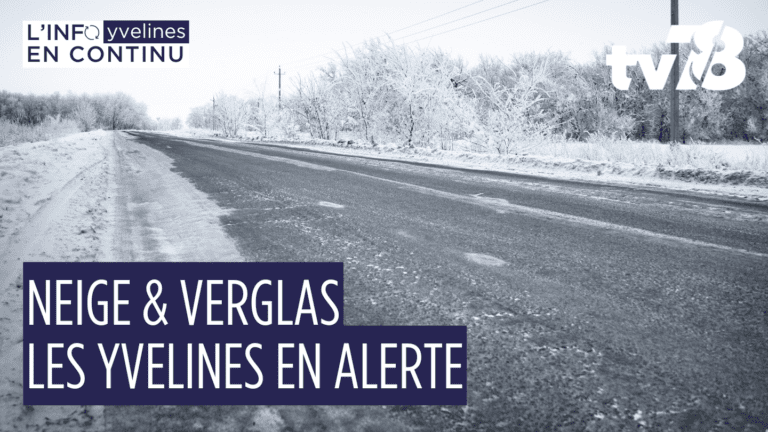À l’Université des maires de l’Ouest parisien (2025), Rafaëlla Fournier (CEREMA) a rappelé que l’aménagement du territoire ne se résume pas à des normes : les habitants et les élus veulent comprendre comment concrétiser les projets. Le succès des politiques de densification ou du « zéro artificialisation nette » dépendra de leur acceptabilité et de la qualité de vie qu’elles promettent. Cet article synthétise l’intervention de l’UMOP et élargit le sujet avec des données et des retours de terrain.
Un atelier pour partager et écouter
Le CEREMA, partenaire des Universités des mairies, intervient pour sensibiliser et partager des retours d’expérience. Rafaëlla Fournier a expliqué que l’objectif de son atelier était de « faire passer des messages » et de sensibiliser sur les questions d’acceptabilité des projets. En pleine période de réserve électorale, l’atelier s’est déroulé sans élu co‑intervenant, mais la démarche reste la même : communiquer sur les études du CEREMA et nouer des partenariats pour accompagner les collectivités. Lors des échanges, les participants ont insisté sur un besoin d’opérationnalité : au‑delà des préconisations, les élus veulent savoir comment mettre en œuvre concrètement les recommandations.
Le contexte national : la loi ZAN et ses évolutions
Depuis 2011, la France consomme en moyenne 24 000 hectares de terres naturelles, agricoles et forestières par an – près de cinq terrains de football chaque heure. La loi Climat et Résilience de 2021 fixe l’objectif d’atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et d’en réduire de moitié le rythme d’ici à 2031. Une réforme complémentaire votée en juillet 2023 (dite « ZAN 2 ») a repoussé les dates d’adaptation des documents de planification et précisé les critères de territorialisation.
En mars 2025, une proposition de loi, dite TRACE, a été adoptée en première lecture au Sénat. Elle reporte l’objectif intermédiaire de 2031 à 2034 et confie aux régions la fixation de leur propre trajectoire de réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le texte prévoit de permettre aux communes d’ouvrir des surfaces supplémentaires à l’urbanisation jusqu’à 20 % de leur enveloppe locale, voire plus avec l’accord du préfet. Ces assouplissements ont pour but de lever les blocages, mais ils suscitent des critiques. Une analyse indépendante souligne que certaines modifications tentent de « vider le ZAN de son contenu » en excluant des projets industriels du décompte d’artificialisation et en autorisant jusqu’à 30 % de dépassement de l’objectif local. Dans ce débat, les élus locaux réclament surtout des outils clairs pour concilier sobriété foncière et développement.
Densifier sans dégrader : quels leviers ?
À l’heure du ZAN, les collectivités font face à des injonctions contradictoires : construire des logements et des locaux d’activités tout en préservant les espaces naturels et en répondant à l’aspiration des habitants à la maison individuelle. Contrairement aux idées reçues, la satisfaction des habitants pour leur cadre de vie n’est pas directement liée à la densité mesurée. Le CEREMA rappelle que la densification est un impératif pour limiter l’étalement urbain et réduire l’empreinte écologique. Elle peut prendre plusieurs formes : construction en dent creuse, surélévation, réhabilitation de logements vacants ou transformation de bureaux en logements.
Toutefois, densifier doit rimer avec qualité. L’institution identifie trois niveaux d’action :
- Bâtiment/parcelle : garantir le confort thermique en été, intégrer la nature sur les toits et façades et proposer des logements modulables.
- Quartier : privilégier les mobilités actives et des services de proximité, s’appuyer sur des indicateurs comme la « ville du quart d’heure » ou le référentiel 3‑30‑300 (trois arbres visibles de chaque logement, 30 % de canopée et un parc à 300 m).
- Ville/EPCI : coordonner densification et trames vertes à grande échelle pour concilier préservation de la nature et développement urbain.
Trois principes écologiques complètent cette méthode : multifonctionnalité (chaque espace doit accueillir plusieurs usages et services écosystémiques), connectivité (reliée les espaces verts et urbains) et évolutivité (adapter les lieux aux changements climatiques et sociaux). Dans les projets urbains, la participation des habitants est un levier clé pour une densification partagée.
Île‑de‑France : un SDRIF‑E pour guider l’aménagement
La Région Île‑de‑France révise actuellement son Schéma directeur (SDRIF‑Environnemental) pour définir l’aménagement jusqu’en 2040. Cette démarche repose sur une large concertation des habitants, associations et collectivités et met l’accent sur les enjeux environnementaux Le projet vise un polycentrisme : renforcer les centres urbains et ruraux de la grande couronne et préserver les espaces naturels et agricoles.
Le SDRIF‑E s’inscrit dans l’objectif ZAN en établissant des enveloppes maximales d’artificialisation par territoire. Il souligne l’importance de protéger la biodiversité et de renaturer les villes, en développant des dispositifs d’accompagnement pour les communes. Pour atteindre la neutralité carbone et encourager l’économie circulaire, la région intégrera dans ses enveloppes foncières les besoins liés aux énergies renouvelables et au traitement des déchets. Le volet logement prévoit la production de 70 000 logements par an tout en mobilisant mieux le parc existant et en privilégiant la proximité des transports. La densification devra s’accompagner d’une adaptation au changement climatique et d’une lutte contre les îlots de chaleur urbains.
Ce que disent les maires
Les élus locaux sont en première ligne pour mettre en œuvre ces politiques. Une enquête du Cevipof publiée en avril 2025 révèle que parmi 5 266 maires interrogés, seuls 42 % comptent se représenter aux élections de 2026. 30 % hésitent et 28 % annoncent déjà leur retrait. La taille de la commune est déterminante : 70 % des maires de villes de plus de 9 000 habitants souhaitent repartir contre seulement 37 % dans les communes de moins de 500 habitants. Ce décrochage s’explique par la solitude croissante des maires dans les petites communes et par le poids des tâches administratives. Les élus évoquent également un sentiment de surexposition et d’insécurité (20 % d’entre eux renoncent par devoir accompli, 19 % pour se protéger), ainsi qu’un manque de moyens financiers, aggravé par la suppression de la taxe d’habitation.
Ces difficultés, conjuguées à la complexité croissante des dossiers (urbanisme, sécurité, aménagement), renforcent le besoin d’appui technique et de solutions concrètes. C’est précisément ce à quoi le CEREMA entend répondre, en partageant des diagnostics et des retours d’expérience et en développant des partenariats opérationnels.
À retenir
Des élus sous pression : moins de la moitié des maires prévoient de se représenter en 2026, citant un manque de moyens, des contraintes réglementaires et une usure psychologique.
Partage d’expérience : le CEREMA mobilise ses études et son expertise pour aider les communes à rendre leurs projets acceptables et adaptés.
Sobriété foncière : le ZAN vise zéro artificialisation nette en 2050 et une réduction de moitié d’ici 2031; des assouplissements discutés en 2025 décalent l’objectif intermédiaire à 2034.
Densité raisonnée : densifier les espaces déjà urbanisés est indispensable pour limiter l’étalement, mais la qualité du logement, les services de proximité et la présence de nature sont des conditions clés.
Planification francilienne : le SDRIF‑E veut concilier polycentrisme, renaturation, neutralité carbone et production de logements.
À lire aussi sur top, actu locale
- UMOP 2025 : au cœur des territoires, les maires face aux grands défis locaux
- Déficit de l’État : les collectivités demandent une visibilité financière
- Yaël Braun-Pivet à l’UMOP : restaurer la confiance institutionnelle
- Muriel Fabre (AMF) : « Les communes restent le socle du lien territorial »
- IA et collectivités : comprendre pour mieux agir
Retrouvez toutes les vidéos, interviews et analyses de l’Université des mairies de l’Ouest parisien sur topactulocale.fr et nos réseaux sociaux.